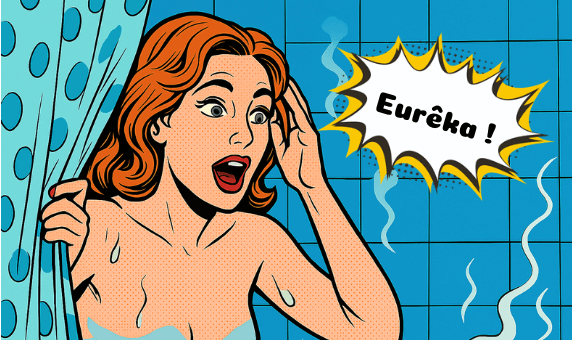Sommaire
ToggleOn en parle partout, on la réclame à l’école, on la vend dans les entreprises… mais de quoi parle-t-on exactement quand on dit « créativité » ?
Est-ce une qualité rare, un don réservé à quelques élus ? Ou une capacité humaine universelle, qu’on pourrait réveiller, cultiver, nourrir ?
Aujourd’hui, on dirait que le mot s’est vidé de sa substance ! Il est presque devenu un slogan.
« Soyez créatifs ! » : ça ressemblerait bien à une injonction paradoxale de type « soyez spontané », vous ne trouvez pas ?
Mais derrière cette injonction, on oublie souvent l’essentiel : la créativité n’est pas une performance, c’est notre vitalité.
Comprendre ce qu’elle est vraiment, c’est aussi comprendre comment penser autrement, se réinventer, et redonner du sens à ce qu’on crée.
Alors, qu’est-ce que la créativité selon la psychologie scientifique ?
Et surtout, comment la retrouver quand elle s’étiole ?
📣 Points clés :
La créativité n’est pas un don, mais une capacité humaine universelle.
Elle est sous-tendue par plusieurs processus et compétences.
La pensée divergente est au cœur de l’originalité.
Motivation, émotions et environnement sont des leviers essentiels.
La créativité se nourrit de lenteur, de curiosité et de plaisir.
Pourquoi on parle autant de créativité aujourd’hui ?
Parce qu’elle est devenue le carburant de notre époque !
Les entreprises la placent au sommet des compétences du futur, les écoles veulent la développer dès la maternelle, les algorithmes la recyclent à la chaîne.
Mais plus on veut être créatif, plus la créativité semble se tarir.
Sur les réseaux, la création s’est transformée en production. Les algorithmes exigent de nourrir toujours plus la machine, quitte à confondre originalité et rendement.
Et dans cette course, beaucoup finissent épuisés, vidés, coupés de leur imagination. Oserais-je dire, coupés d’une partie essentielle de leur être ?
Parce que la créativité n’est pas qu’un moteur de croissance ou d’innovation.
Elle est une source de vitalité psychique. C’est ce petit espace intérieur où l’on ose rêver, inventer, jouer.
Perdre le lien avec sa créativité, c’est perdre un peu de cette souplesse mentale qui rend le monde supportable en apportant un peu de magie à nos quotidiens.
Cet article est un résumé de l’épisode 43 du Podcast Hack Your Soul.
Des Muses à la psychologie scientifique : aux origines du concept
La créativité n’a pas toujours été perçue comme une compétence. Longtemps, elle relevait du mystique, du divin.
L’inspiration venue d’ailleurs
Dans l’antiquité, on pensait que l’esprit humain n’inventait rien : il recevait.
Platon évoquait la Muse comme une source d’inspiration sacrée, insufflant au poète son souffle créateur.
Aristote, lui, amorce un tournant : il parle d’introspection, de l’idée que la créativité puisse venir du for intérieur, des associations mentales et de la réflexion personnelle.
Puis, au Moyen Âge, le sujet s’efface derrière la religion. L’acte de créer doit servir Dieu, non l’individu.
Le génie renaissant
La Renaissance redonne à l’homme son pouvoir créateur. On célèbre le génie individuel, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Galilée ; capables d’associer science et art.
Mais ce génie reste perçu comme une exception. On naît créatif, on ne le devient pas.
De la mythologie à la méthode
Au XIXe siècle, la science s’empare du sujet. On commence à parler de processus plutôt que… de miracle.
Francis Galton, cousin de Darwin, propose un continuum entre les individus peu créatifs et les génies.
L’idée d’un modèle mesurable s’installe.
Et au XXe siècle, la psychologie expérimentale se charge de décortiquer le phénomène.
La créativité selon la psychologie scientifique
La psychologie a permis de comprendre que la créativité n’est ni magique, ni aléatoire.
Elle obéit à des mécanismes cognitifs et émotionnels précis, qu’on peut observer, stimuler, parfois même entraîner.
Les quatre étapes du processus créatif
En 1926, le chercheur Graham Wallas formalise le processus créatif en quatre temps :
Préparation : on collecte des informations, on s’imprègne du sujet.
Incubation : l’esprit laisse reposer, travaille en arrière-plan.
Illumination : c’est le fameux eureka, la révélation soudaine.
Vérification : on teste, on ajuste, on concrétise.
Ce modèle reste aujourd’hui un point de repère, car il montre que la créativité demande à la fois du temps conscient et du lâcher-prise.
La pensée divergente : ouvrir les possibles
Dans les années 1950, le psychologue J. P. Guilford introduit la notion de pensée divergente.
C’est la capacité à explorer plusieurs pistes à partir d’un même point de départ.
Là où la pensée convergente cherche la bonne réponse, la pensée divergente en cherche plusieurs.
C’est elle qui alimente le brainstorming, l’improvisation, les jeux d’association d’idées.
Autrement dit, plus on multiplie les pistes d’idées, plus on augmente les chances d’en trouver une qui sera originale et adaptée, autrement dit, créative.
Les modèles contemporains
Dans les années 1990, deux modèles dominent la recherche.
Teresa Amabile (Harvard) décrit la créativité comme l’interaction entre :
la motivation (intrinsèque ou extrinsèque),
les compétences du domaine (connaissances, techniques),
et le processus créatif (curiosité, persévérance, flexibilité cognitive).
Sternberg et Lubart, eux, parlent de six ressources nécessaires :
L’intelligence (notamment la capacité à penser différemment)
La connaissance
Le style cognitif
La personnalité
La motivation
L’environnement
Leur théorie montre que ces ressources peuvent se compenser. Par exemple, un manque de connaissances peut être compensé par une forte motivation, ou un environnement stimulant.
Le rôle des émotions et du contexte
Les émotions jouent un rôle essentiel.
La joie, la curiosité, la surprise favorisent la flexibilité cognitive.
Mais une émotion trop intense ou mal régulée, peur, anxiété, colère ; peut bloquer le processus en réduisant la persévérance.
La créativité est donc un équilibre entre tension et détente, entre ouverture et structure.
Et elle ne se limite pas à l’individu : elle dépend aussi du regard social et culturel.
Une idée n’est créative que si elle est reconnue comme telle.
La société choisit ce qu’elle valorise : c’est le consensus social qui fait (ou défait) la création.
Deux jeux pour réveiller l’imaginaire
Le cadavre exquis
Inventé par les surréalistes, ce jeu collectif consiste à composer une phrase ou un dessin à plusieurs, sans connaître les ajouts précédents.
Résultat : des associations absurdes, poétiques, libératrices.
C’est un moyen simple de lâcher le contrôle et de renouer avec la spontanéité.
La connexion forcée
Ouvrez le dictionnaire au hasard et prenez-y deux mots.
Imaginez une histoire ou une métaphore qui les relie.
Ce jeu stimule les associations d’idées, l’un des piliers de la pensée créative.
Ces deux exercices ne demandent aucun talent particulier, seulement une dose de curiosité et un peu de lâcher prise !
Redonner du sens à la créativité
La créativité, c’est ce qui nous rend profondément humains.
C’est la capacité à transformer le réel, à imaginer d’autres possibles, à faire dialoguer les contraires.
Elle nous relie aussi au monde et aux autres.
Dans un univers saturé d’informations et d’IA, préserver sa créativité, c’est résister à l’automatisme et au dévidage de la pensée.
C’est choisir la lenteur, la nuance, la singularité.
La créativité ne se cherche pas, elle s’autorise.
Elle se manifeste quand on cesse de vouloir produire et que l’on retrouve le goût du jeu, du lien et de la rêverie.
📚 Source : Psychologie de la créativité, Todd Lubart, Sylvie Tordjman, Franck Zenasni, Christophe Mouchiroud